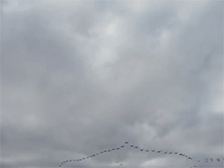2. LE VOL ET L’EFFICIENCE DE CELUI-CI
Cette partie va développer le vol de la cigogne une fois qu’elle a réussi à décoller, elle est alors soumise à de nouvelles contraintes. Nous allons parler ici de forces physiques intervenant pendant le vol comme l'aérodynamisme, la traînée, ainsi que les courants ascendants et l’organisation des plumes et des ailes chez la cigogne.
Lors de son vol la cigogne utilise toujours le vol battu, mais aussi le vol à voile. Il consiste à se laisser porter par les courants d’air ascendants ou descendants sans battre des ailes, donc en effectuant un vol plané, cela leur permet de prendre ou de perdre de la hauteur.
1.L’aérodynamisme avec l’organisation des plumes et des ailes :
Les plumes :
Les plumes de cigognes possèdent des caractéristiques nécessaires au vol.
Tout oiseau possède des plumes. Celles des cigognes et de tous les oiseaux sont fixées
dans la peau grâce aux follicules de celle-ci, qui sont des trous où le calamus - extrémité
creuse de la plume qui ressemble à une tige - rentre dans la peau et prend racine.
Cela permet aux plumes de résister aux battements d’ailes de la cigogne et donc de ne
pas tomber durant le vol. En suivant cette “tige” on trouve le rachis, ou la hampe, elle
sépare la plume en deux et permet aux barbes, les petites branches alignées, de trouver
un point d’accroche.
Ensuite pour chaque barbe, on a encore de chaque côté environ 500 barbules qui suivent
le même modèle qu’entre la hampe et les barbes. Ces barbules possèdent enfin des
barbicelles ou des hamuli, qui ont pour rôle de maintenir les barbes et barbules imbriqués
grâce à leur forme de minuscule crochet et qui permet de rendre imperméable les plumes.
Ceci sert car lors du vol, il peut se mettre à pleuvoir, ainsi l’imperméabilité de celle-ci permet à la cigogne de ne pas s’alourdir en accumulant l’eau, ce qui l’empêcherait encore une fois de voler car ses muscles ne seraient pas suffisant pour battre des ailes.
Le lissage consiste à lisser les vexilles (une moitié de la plume) à l’aide du bec pour améliorer et optimiser le positionnement des barbules entre elles et ainsi d’optimiser l’imperméabilité et donc le vol.
Photos au microscope d’une plume de faisan (x20 et x400) Photos au microscope de plume de buse (x20 et x400)
Sur ces photos on peut voir l’organisation d’une plume grâce au microscope. Cela nous permet de comprendre pourquoi on ne peut pas voir les barbules à l’oeil puisqu’ils font 20 µm. Ce qui est 5 fois plus petit qu’un cheveu.
L’organisation de l’aile :
En plus de cela, la façon dont ces plumes sont organisées sur l’aile revêt une grande importance car c’est grâce à elle que la cigogne pourra gagner de l’altitude ou inversement.
Les plumes poussent en suivant une fente. L’organisation des plumes est d’une importance cruciale au niveau des ailes et de la queue, car ce sont les éléments qui permettent de tourner dans les airs. Les ailes, elles, forment la surface de référence pour la portance de la cigogne, comme les plumes sont bien organisées elles forment une surface solide, donc l’air ne passe pas à travers et porte l’oiseau comme nous avons pu le voir avec la portance. De plus en fonction de l’orientation de l’aile et grâce à l’expérience sur la résistance de l’air on peut voir que cela permet d’incliner l’oiseau, de le freiner, descendre, monter, en fonction de la position de l’aile et dont la façon dont le vent contourne l’aile.
Les plumes les plus communes sont les pennes, on les retrouve :
-
Au niveau de la queue où elles forment les rectrices. Elles permettent à la cigogne de tourner dans les airs, d’être stable et de freiner pour atterrir.
-
Les rémiges qui sont fixées aux os et sont assez solides pour permettre à la cigogne de voler. → Il existe trois types de rémiges en fonction de leur positionnement :
-
Les rémiges primaires sont les plumes de l’extrémité de l’aile, elles sont très longues et permettent à la cigogne de se propulser.
-
Les rémiges secondaires qui aident les rémiges primaires pour la portance de la cigogne et sont au centre de l’aide, elles sont plus souples que les primaires.
-
Les rémiges tertiaires qui sont tout près du corps de la cigogne et permettent la réduction de turbulences qui pourraient être problématique en vol.
-
Les tectrices qui sont des plumes qui se superposent avec les rémiges, leur objectif est de garder la température corporelle, si il n’y avait pas les tectrices, l’air qui traverse pourrait refroidir fortement la cigogne. En effet la température baisse de 0.65°C tous les 100 m. Si la température est trop basse, les ailes peuvent geler et ne plus pouvoir bouger. Si c’est pendant le vol, alors l'oiseau tombe, ou alors il peut aussi mourir de froid. Il y a :
-
Les tectrices primaires, qui sont situés par dessus les rémiges primaires.
-
Les moyennes tectrices primaires qui ont le même rôle mais protègent les rémiges secondaires et tertiaires.
-
En plus des pennes, il y a aussi les filoplumes qui ont un rachis très fin et seulement quelques barbes à l’extrémité du rachis. Ces plumes sont situées autour des tectrices et permettent à la cigogne de connaître précisément la position des autres plumes, pour mieux les remettre en place et donc optimiser son vol, elles sont très importantes. Elles fonctionnent car le rachis de ces filoplumes possède de nombreuses terminaisons nerveuses et chaque plume alentour est reliée aux nerfs de la filoplume. Ainsi, l’oiseau se rend compte de la bonne ou mauvaise position des plumes.
En-dessous des tectrices, il y a une couche de plumules ou duvet, qui est toujours présente dans un soucis de garder la température corporelle, permettant à la cigogne de rester au chaud. La hampe des plumules est rigide et les barbes sont douces.
De plus, pour conserver sa chaleur, la cigogne possèdent des pennes, pouvant se déplier et permettant de “piéger” l’air autour de l’oiseau. Ceux-ci vont peu à peu se réchauffer, tout en étant proche de la cigogne. Le duvet fonctionne de la même manière, tout comme le système des mammifères, qui hérissent leurs poils.
L’aile de la cigogne est une aile à allongement modéré, elle mesure environ 80 cm. Elle possède une importante courbure en arc, et une extrémité fortement découpée (il s’agit de l'émargination). Ces ailes sont bien adaptées au vol de longue distance. L'aile large réduit la charge "alaire" - qui est une mesure utilisée en ornithologie pour expliquer le rapport entre la masse au décollage de l'oiseau et la surface portante de son aile. Cette mesure s'exprime en kg/m² - et permet un vol lent. L'émargination, qui est créée par la séparation des grandes plumes, réduit la turbulence en augmentant ainsi la portance.
Contre-exemple de la chauve-souris :
La chauve-souris est l’unique mammifère à pouvoir voler activement, même sans plumes. Cette capacité de vol exceptionnelle a été obtenue grâce à des adaptations morphologiques exceptionnelles : ses doigts se sont allongés et une membrane est apparue : le patagium, permettant la portance. Ainsi, contrairement aux oiseaux, la chauve-souris vole avec ses mains, c’est la famille des Chiroptères (volent avec leurs mains).
La chauve-souris possède un vol désordonné qui est moins gracieux que celui des oiseaux. Des chercheurs de l’Université de la Californie du Sud et de l’Université Lund en Suède ont découvert que les chauves-souris, à chaque coup d’aile, prennent de la hauteur en tournant leurs ailes vers l’arrière. Cette capacité leur permet de changer rapidement et fréquemment de direction.
Aérodynamisme :
Les plumes des cigognes sont relevées au bout de leurs ailes et forment ainsi une
sorte de barrière empêchant l'air en surpression de remonter sur l'extrados - face
supérieure de l’aile - , limitant ainsi les tourbillons formés. Ces rémiges
(grandes plumes des ailes des cigognes) étant mobiles, la cigogne peut, par ce fait,
les resserrer ou les écarter selon sa vitesse, son inclinaison et la force du vent pour
ainsi limiter de façon efficace les tourbillons.
Elle peut également rediriger ces tourbillons pour créer une portance plus importante,
en suivant un mouvement compliqué. Ces adaptations sont concluantes, puisque les
tourbillons sont réduits de façon conséquente, ce qui augmente la vitesse du volatile et
réduit ainsi sa consommation d'énergie. Ce système est très efficace, puisque aujourd'hui,
presque tous les avions de lignes sont équipés de ces <<rémiges>>, connues sous le
nom de <<winglet>>, c’est du biomimétisme.
De plus, par sa corpulence, la cigogne peut s’élever facilement dans les airs, comme
nous le montre l’image ci-contre :
Les courants passent au-dessus et en dessous de l’oiseau, ce qui augmente ainsi
son aérodynamisme et, par ce fait, sa vitesse. L’aérodynamisme est donc utile à la
cigogne lors de son vol, mais d’autres forces interviennent durant le vol de la cigogne.
2. Les forces (portance, gravitationnelle, traînée) :
Lors du vol en haute altitude, la cigogne subit encore la portance, d’après les calculs de portance précédemment énoncés, c’est égal à : 1,9 x 10^-4. Car à cette hauteur la température est en moyenne égal à 5°C (à 1 500 m d’altitude), ce qui change la formule. La force de portance à cette hauteur, elle est égale à 3.3*10^1 N.
La force de traînée est une force qui s’oppose au mouvement du corps de la cigogne dans l’air en créant des frottements.
Elle subit principalement la traînée de frottement, ce qui provoque des variations de vitesse mais aussi la traînée induite créée par la portance avec des tourbillons formés en bout d’aile, dû à l’égalisation des pressions de part et d’autre des ailes.
La force de gravité (ou force gravitationnelle) est la force qui s’exerce entre deux objets qui ont une masse. Elle est responsable de la chute des objets et donc du fait que la cigogne est en permanence attirée vers la surface de la Terre. Pour éviter cela elle doit battre des ailes, sinon elle tombe.
3.L’efficience énergétique :
Cependant pour voler jusqu’en Afrique la cigogne utilise des particularités
comme le vol en V, l’utilisation de courants ascendants ainsi que le vol à
haute altitude, qui lui permettent de voler plus longtemps.
Les oiseaux migrateurs, comme les cigognes, ont un intérêt de voler assez haut,
puisqu’ils profitent de courants de vents assez forts qui les aident à se déplacer sur
de grandes distances puisque si ils sont dans la bonne direction ils peuvent pousser
la cigogne. L'augmentation de l'altitude de vol permet aussi de limiter l'hyperthermie
(hausse de la chaleur corporelle liée à l'intensité des battements d'ailes), notamment
grâce à la température qui peut atteindre les -50 °C, voir moins. Pour atteindre
ces altitudes, ils utilisent des vents ascendants qui les font monter encore bien plus
haut avec très peu d’effort.
Leur voyage n'est donc pas de tout repos car les conditions climatiques sont très difficiles et très rudes à ces hauteurs. C’est pour cela que ces oiseaux bénéficient d'adaptations physiologiques importantes. Pour faire face à des variations rapides d'altitude, donc des variations de pression de l'air, certains de ces volatiles possèdent différents types d'hémoglobines (protéines qui fixent l'oxygène dans le sang) qui interviennent à différentes altitudes.
La formation en V (ou formation en chevron) permet à la cigogne de parcourir de longues distances. Cette formation est très efficace, car elle transfère des vortex (tourbillon suivant un mouvement de rotation autour d’un axe comme le tourbillon dans la baignoire), qui sont créés par des sortes de frottements, dues à la force qui s’oppose au mouvement d’un corps (ici les ailes de la cigogne). Ces frottements sont appelés traînées, créés jusqu'au bout de la formation.
Il y deux hypothèses concernant l’utilité de ce vol :
-
Cette formation pourrait augmenter l'efficacité énergétique. Les oiseaux se relaient puisque les oiseaux en tête et les deux derniers s'épuisent plus que les autres. On peut comparer le vol en V avec le Peloton dans le cyclisme, puisque dans les deux cas, il y a le phénomène d’aspiration qui rentre en jeu. Dans le cyclisme, le coureur en tête se fatigue plus vite que les autres du fait de la résistance des fluides (l’air par exemple, puisque c’est un milieu déformable). Les autres coureurs auront donc une diminution de la masse d’air, donc une moins grande résistance des fluides. Grâce à ce phénomène, les autres cyclistes, auront, pour le même effort, dépensé moins d’énergie.
-
L’autre hypothèse est que la cigogne, en se déplaçant de cette sorte, cherche la présence de courants ascendants non repérables à la vue, sauf si l'on passe dedans : ils sont invisibles. Ainsi, avec cette formation, les oiseaux couvrent plus d’espace dans le ciel et ont plus de chances de trouver ces courants.
Un courant ascendant transporte de l’air chaud vers le haut dans la partie
atmosphérique de la Terre. Ce qui crée ce courant est une différence de température
dans une zone entre l’air et l’environnement qu’il entoure ; si l’air est plus chaud, il
remonte dans l’atmosphère. Ainsi, par sa faible densité, en remontant,
il laisse de la place à de l’air plus frais. Ce courant peut donc se produire par
exemple, par un réchauffement du sol par le Soleil. Plus la différence de température est
importante, plus le phénomène sera important et fréquent.
Les lieux où il y a plus de chances de trouver ce phénomène sont au dessus de la
terre ferme ainsi que les zones urbaines car le goudron absorbe énormément d'énergie
et donc réchauffe la couche d'air près du sol.
Les étendues d'eau ne possèdent donc pas les caractéristiques pour la formation de courants ascendants. C’est donc pour cela que les cigognes attendent et mettent beaucoup de temps pour se reposer avant de traverser la Mer Méditerranée. Durant cette traversée, elles seront obligées d’effectuer un vol battu, utilisant beaucoup d’énergie. Mais si elles sont trop fatiguées, elles n’ont pas d’endroit où se poser avant d’arriver sur l’autre continent.
La vitesse des courants ascendants est de quelques mètres par seconde. Ainsi en étendant ses ailes, et par le maillage des plumes de la cigogne et des oiseaux, ces volatiles sont portés par l’air, leur permettant d’atteindre une haute altitude. Une fois arrivée en haut de ce courant ascendant, il leur suffit alors de se laisser planer pour parcourir une longue distance sans consommer beaucoup d’énergie. En effet, il est estimé à 23 fois moins d’énergie d’utiliser un courant ascendant que de faire un vol battu pour parcourir la même distance. Cette différence s’explique car lors du vol plané, les oiseaux utilisent moins de muscles pour voler que lors du vol battu.